Scusate il ritardo ma ieri a causa del maltempo la<connessione era sconnessa>. Dovremmo organizzare dei sistemi di comunicazione alternativi alla rete che è in mani altrui!…piccioni viaggiatori?..pizzini?..tam tam? pensiamoci!
Colette Guillaumin: Pratica del potere e idea di natura – (1) L’appropriazione delle donne
Testo pubblicato in Questions féministes N°1-Novembre 1977
PROLOGO
Questa mattina, ho visto ciò che il buon senso popolare chiama un matto e la psichiatria un maniaco, in avenue du Général-Leclerc, a Parigi. Agitava le braccia e balzava da un marciapiede all’altro. Parlava, parlava e con grandi gesti mulinanti spaventava le persone che passavano, prendendoci apparentemente un grande gusto perchè rideva forte quando riusciva a ottenere un gesto di terrore.
Quindi spaventava i passanti. I passanti? Alla fin fine, se vuoi, però in realtà quest’uomo sulla sessantina faceva questo gesto di destabilizzazione alle donne. Donne, giovani e vecchie, ma non uomini. Davvero un gesto di destabilizzazione coinvolgente, e persino, a una giovane donna, ha cercato di afferrarle il sesso. Ridendo ancora di più.
Ora, non si prende pubblicamente se non ciò che ti appartiene; anche i cleptomani più sfrenati si nascondono per cercare di prendere ciò che non è loro. Quando questo riguarda le donne invece evidentemente non ha senso nascondersi. Sono un bene comune e se la verità è nel vino, nella bocca dei bambini e in quella dei pazzi, questa verità ci viene chiaramente detta molto spesso.[…]
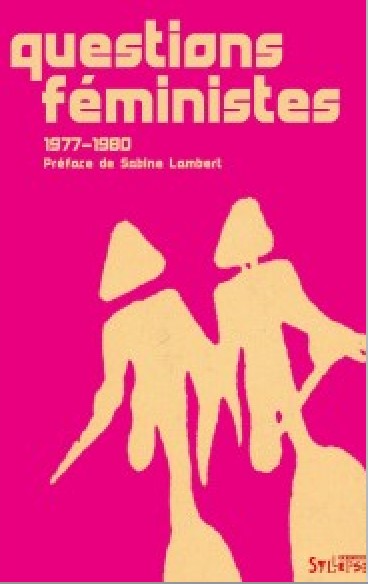
Apologue
Ce matin, je voyais ce que le bon sens populaire appelle un fou et les psychiatres un maniaque, dans l’avenue du Général-Leclerc, à Paris. Il faisait de grands gestes des bras et sautait à grandes enjambées d’un côté du trottoir à l’autre. Il parlait, parlait et avec de vastes moulinets faisait peur aux gens qui passaient, en y prenant apparemment un grand plaisir puisqu’il riait aux éclats lorsqu’il parvenait à obtenir un geste d’effroi.
Il faisait donc peur aux passants. Aux passants ? Enfin, si on veut, car en fait, cet homme d’une soixantaine d’années faisait ce geste de précipitation enveloppante aux femmes. Aux femmes, jeunes et vieilles, mais non pas aux hommes. Un geste de précipitation enveloppante en effet, et même, pour une jeune femme, il a tenté de lui prendre le sexe. Il a encore bien davantage ri.
Or on ne prend publiquement que ce qui vous appartient ; même les kleptomanes les plus débridés se cachent pour tenter de saisir ce qui n’est pas à eux. Pour les femmes, c’est inutile de se cacher. Elles sont un bien commun, et si la vérité est dans le vin, la bouche des enfants et celle des fous, cette vérité-là nous est claire-ment dite bien souvent.
La publicité même de cette mainmise, le fait qu’elle revête aux yeux de beaucoup, et en tout cas des hommes dans leur ensemble, un tel caractère de « naturel », de quasi « allant-de-soi », est l’une de ces expressions quotidiennes et violentes de la matérialité de l’appropriation de la classe des femmes par la classe des hommes. Car le vol, l’escroquerie, le détournement se cachent, et pour approprier des hommes mâles il faut une guerre. Pas pour les hommes femelles, c’est-à-dire les femmes… Elles sont déjà propriété. Et lorsqu’on nous parle, à propos d’ici ou d’ailleurs, d’échange des femmes, on nous signifie cette vérité-là, car ce qui « s’échange » est déjà possédé ; les femmes sont déjà la propriété, antérieurement, de qui les échange. Lorsqu’un bébé mâle naît, il naît futur sujet, qui aura à vendre lui-même sa force de travail mais pas sa propre matérialité, sa propre individualité. De plus, propriétaire de lui-même, il pourra également acquérir l’individualité matérielle d’une femelle. Et de surcroît il disposera également de la force de travail de la même, dont il usera de la manière qui lui conviendra, y compris en démontrant qu’il ne l’utilise pas.
Si vous n’avez pas peur des exercices amers, regardez dans la rue comment les jeunes amants ou amoureux se donnent la main, qui prend la main de qui ? et marche légèrement devant… oh ! à peine, une esquisse… Regardez comment les hommes tiennent « leur » femme par le cou (comme une bicyclette par le guidon) ou comme ils la tirent à leur bras (comme le chariot à roulettes de leur enfance…). C’est selon l’âge, et les revenus, mais les rapports corporels crient cette appropria-tion, dans chaque accent de la motricité, de la parole, des yeux. Et je finis par me demander sérieusement si ce geste masculin supposé galant, et qui, d’ailleurs, tend à disparaître, de « laisser le passage » à une femme (c’est-à-dire de la faire passer devant) n’était pas simplement l’assurance de ne pas la perdre de vue une seconde : on ne sait jamais, même avec des talons très hauts, on peut courir, et fuir.
Les habitudes verbales nous le disent aussi. L’appropriation des femmes est explicite dans l’habitude sémantique très banale de mentionner les acteurs sociaux femmes prioritairement par leur sexe (« femmes », les femmes), habitude qui nous irrite beaucoup, polysémique bien évidemment, mais dont justement cette significa-tion-là est passée inaperçue. Dans n’importe quel contexte, qu’il soit professionnel, politique, etc., toute qualification en ce domaine est omise ou refusée aux acteurs de sexe féminin, alors que bien entendu ces mêmes qualifications désignent seules les autres acteurs. Ces phrases par exemple, relevées dans les dernières quarante-huit heures : « Un élève a été puni d’un mois d’arrêts de rigueur, une jeune fille a reçu un blâme… » (information sur la répression à Polytechnique) ; « Un président de société, un tourneur, un croupier et une femme… » (à propos d’un groupe réuni pour opiner sur un sujet quelconque) ; « Ils ont assassiné des dizaines de milliers d’ouvriers, d’étudiants, de femmes… » (Castro, à propos du régime Battista). Ces phrases, dont l’imprécision (croyons-nous) quant au métier, quant au statut, quant à la fonction dès qu’il s’agit de femmes nous exaspère tellement, ne sont pas des phrases fautives par omission d’information. Elles sont au contraire informativement exactes, ce sont des photographies des rapports sociaux. Ce qui est dit et uniquement dit à propos des êtres humains femelles, c’est leur position effective dans les rapports de classe : celle d’être en premier et fondamentalement des femmes. Leur socialité c’est cela, le reste est de surcroît et – nous signifie-t-on – ne compte pas. En face d’un patron il y a une « femme », en face d’un polytechnicien il y a une « femme », en face d’un ouvrier il y a une « femme ». Femme nous sommes, ce n’est pas un qualificatif parmi d’autres, c’est notre définition sociale. Folles qui croyons que ce n’est qu’un trait physique, une « différence » et qu’à partir de ce « donné » de multiples possibilités nous seraient ouvertes. Or ce n’est pas un donné, c’est un fabriqué auquel on nous signifie sans cesse de nous tenir. Ce n’est pas le début d’un processus (un « départ », comme nous le croyons), c’en est la fin, c’est une clôture.
Au point même qu’on peut très bien tenter de nous extraire d’une information où nous aurions pu nous glisser sous une marque frauduleuse, de nous en sortir pour nous rendre notre vraie place (nous remettre à notre place) : « Trois agents communistes, dont une femme… » (à propos de l’espionnage en Allemagne fédérale). Et voilà ! Une femme n’est jamais qu’une femme, un objet interchangeable sans autre caractéristique que la féminité, dont le caractère fondamental est d’appartenir à la classe des femmes.[…]







